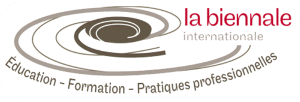Extraits d’une rencontre
de Joris Thievenaz avec François Laplantine
François Laplantine dédicacera ses ouvrages au Foyer à l’issue de sa conférence le jeudi 21 septembre de 11 heures à 11 h 30
L’expérience de terrain
François Laplantine « C’est une expérience susceptible de transformer les uns et les autres.
D’abord, la présence est indispensable ! Aujourd’hui, certains anthropologues – qui, à mon avis, n’en sont plus – en viennent à parler de « e-terrain » pour désigner des informations prises à distance, puis mises en ligne, etc. Alors que la présence est nécessaire dans la mesure où, comme j’ai pu le constater dans mon parcours (d’abord en Afrique, puis au Brésil et au Japon), l’expérience du terrain va provoquer une perturbation, y compris chez le chercheur. C’est pourquoi je travaille toujours en lien avec la psychanalyse. Il y a toujours une distorsion imposée par l’inconscient et que nous ne maîtrisons pas. Cela invite à tenir compte de ce que l’on nomme le contre-transfert, qui désigne non seulement la réaction du clinicien, mais aussi celle que le chercheur développe dans le rapport qu’il entretient avec ses interlocuteurs. L’auteur qui m’a beaucoup influencé et avec qui j’ai réalisé ma thèse est Georges Devereux. Il avait une double expérience : celle du terrain au Viêtnam dans une population qui s’appelle les Sedang moï, où il développe un contre-transfert négatif, et celle des Indiens mohave dont il tombe amoureux (contre-transfert positif), à tel point que lorsqu’il est mort, ses cendres ont été dispersées dans l’océan en pays mohave. Cela signifie que l’on n’est jamais neutre dans une relation d’« enquête ». Généralement, l’anthropologue choisit de travailler dans une population qu’il aime et noue, à cette occasion, une relation qui peut s’avérer idéalisée ou survalorisée, voire amoureuse. Le cas inverse est aussi possible : dans Un peuple de fauves (1973), Colin Turnbull explique comment il déteste la population qu’il étudie. Quand je suis allé au Brésil, j’y suis resté longtemps. J’ai été initié au candomblé (une religion afro-brésilienne), et c’est ainsi que ce pays est devenu une partie de moi ! Comme le disait Fernand Braudel, « le Brésil m’a rendu plus intelligent ». C’est pourquoi, lorsque je formule des connaissances sur le Brésil, je dois tenir compte de ce contre-transfert positif. En revanche, j’ai travaillé en Tunisie sur un rituel qui s’appelle la hajba, qui est la préparation de la fiancée au mariage dans l’île de Djerba : la jeune fille est enfermée durant trois ou quatre mois, afin qu’elle prenne du poids et que sa peau devienne blanche. J’ai éprouvé une relation d’antipathie à l’égard d’un phénomène (contre-transfert négatif) qui provoquait des suicides chez les jeunes femmes. Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner la recherche, mais il faut en tenir compte.
Dans la relation au terrain, il faut ainsi que se noue une relation de partage qui peut être de l’ordre de l’intime. À cet égard, Totalité et infini de Lévinas m’a beaucoup aidé car, dans la relation de terrain, ce qui compte, c’est le visage, et surtout le regard. C’est à partir de là que se dessine la relation éthique. Cela rejoint la question de la présence indispensable. Cette relation n’est ni vectorielle ni unilinéaire, comme un sujet qui irait vers l’objet, c’est une relation de partenaires, une pulsation, un temps de sympathie qui peut aller jusqu’à l’identification (quand, dans le candomblé, je m’identifie à des orixás), mais qui n’empêche pas une temporalité ultérieure de distance critique. Un ouvrage d’anthropologie est réussi lorsque les acteurs ne se reconnaissent pas totalement, car l’ethnologue n’est pas le porte-parole d’une cause(…)
Le partage du sensible
(…) J’ai emprunté l’expression « partage du sensible » à Jacques Rancière, mais je l’utilise dans un autre sens pour désigner cette temporalité de la recherche marquée par l’empathie, la sympathie, qui peut aller jusqu’à l’identification. Mais ce qui est aussi important est l’écart. Je travaille sur le théâtre en ce moment, et il y a toujours une tension dramaturgique entre la conception d’Antonin Artaud dans laquelle l’acteur ne joue pas – mais il est possédé par son rôle – et celle, à l’inverse, de Bertolt Brecht, où la « distanciation » doit conduire à la « conscientisation » et à la pensée critique. Dans l’anthropologie, plus que dans d’autres disciplines, cette même tension existe. C’est notamment ce qui fait que les gens ne nous comprennent pas exactement, parce qu’ils nous imaginent porte-parole d’une cause…
La société brésilienne est très complexe, mais on peut néanmoins y trouver des repères car c’est une société qui s’est formée au contact du catholicisme, de processus de la colonisation, etc. En revanche, quand je suis allé en Asie pour la première fois, tous mes repères étaient perdus : d’abord en Chine, puis au Japon où je continue de séjourner tous les ans. Cela a été l’occasion de rencontrer une notion qui s’est imposée à moi et que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : celle de Wu wei. C’est habituellement traduit par « non-agir », ou « passivité », mais cela signifie plutôt agir avec discernement, ou prendre le temps. Cela traduit une disponibilité à l’événement, à la rencontre. Les langues indo-européennes, et notamment la langue française, ne permettent pas de penser cette notion car elle va presque toujours du sujet à l’objet. Il y a quelque chose dans la pensée japonaise qui permet de penser ce qui vient vers vous, sans que vous en ayez la maîtrise totale. Le verbe le plus utilisé en japonais est imasu, arimasu, que l’on peut traduire par « il y a », « il arrive ». On ne peut pas dire en japonais ou en chinois, « je pense donc je suis », qui apparaitrait comme la parole d’un fou. Même commencer par « je » (watachi wa) est très rare ; seuls les enfants parlent ainsi. Cette langue privilégie les phrases impersonnelles. Je ressens une modestie dans cet écart linguistique : on ne « va » donc pas sur le terrain, il y a quelque chose qui advient dans une relation au terrain que vous ne maîtrisez pas totalement ; il faut accepter cet abandon de l’égoïsme et du fantasme de la toute-puissance, et noter ce qui vous arrive (…)
Il y a des choses qui ne s’apprennent pas. J’ai rencontré des anthropologues très connus qui ne savent pas s’y prendre : ils pontifient alors que l’expérience du terrain consiste non pas à apprendre aux autres, mais à désapprendre, à se départir de… Il y a un effort d’humilité que Gaston Bachelard a très bien montré dans La formation de l’esprit scientifique (1938). Les deux qualités du chercheur sont la modestie et la curiosité. Il faut s’intéresser à tout et tout doit être mis sur un pied d’égalité. Le tout petit détail qui arrive (un moustique qui vient vous piquer, le sourire d’un enfant…) est aussi important qu’un discours solennel. Il n’y a pas de hiérarchisation dans l’observation. L’attitude est celle d’une attention flottante, comme on la rencontre dans la psychanalyse. Un discours libre. Dans un premier temps, ce n’est pas organisé discursivement. Il n’y a pas que du discours au sens étymologique du terme de « ce qui rompt le cours » ; il y a aussi du sensible car tout n’est pas dit, tout n’est pas explicite, il y a des silences, des sensations discrètes à la limite du perceptible…
En cela, je dois beaucoup à Wittgenstein, et notamment à la fin du Tractacus logico-philosophicus : « Ce que l’on ne peut pas dire, il faut le taire. » mais il dit également : « Ce que l’on ne peut pas dire, nous pouvons le montrer. » C’est là que le cinéma et le théâtre m’intéressent, dans cette possibilité de montrer ce qui ne peut pas être dit. Montrer par le corps, par la photo, par la peinture, par la musique… Cette seconde proposition se retourne dans une troisième : « Ce que l’on peut montrer, il faut tenter d’en parler. » L’anthropologie ne doit pas aboutir à une position complaisante selon laquelle il y aurait du « mystère à préserver » ou des « choses à ne pas dire ». La réalisation des limites du langage est au plus fort chez Lao Tseu, dans le Tao-tö-king. Même chez Confucius, le langage est mis en question. Comprendre les limites du langage ne conduit pas à y renoncer mais nous incite à le remettre au travail. Ce que je fais se situe en permanence dans cette tension entre le sensible et le discours. Le sensible qui dépasse le langage, non pas au sens de ce qui le transcende, mais qui l’exaspère, le met à l’épreuve, montre ses limites et en même temps le remet au travail. D’où l’intérêt de la description ethno-graphique : décrire avec la plus grande précision une situation ou une relation. C’est cela le terrain ! C’est beaucoup plus compliqué que des constructions seulement intellectuelles (…)
Les carnets de terrain
Je fais comme tout le monde : j’ai des carnets de terrain. On marque, on écrit et il se forme des strates. Cela prend beaucoup de temps pour passer de ce qui n’est pas du tout organisé (des matériaux bruts qui peuvent aussi être des photos, des films) à quelque chose de plus organisé qui, peu à peu, s’élabore. Un exemple du genre est l’ouvrage de Roland Barthes sur Tokyo, L’empire des signes (1970). Il mêle des photos, des images, des dessins, du graphisme ; il enregistre tout, puis il organise l’ensemble dans un texte. Je ne m’oppose pas du tout à une démarche scientifique. Tout cela doit ensuite être partagé, discuté, questionné par les chercheurs. À ce propos, il faut aussi évoquer le modèle de traduction. Quand on construit le texte, on passe à un exercice de traduction dans lequel il n’y a pas vraiment d’équivalent. Entre l’observation directe, ce que l’on note dans les carnets de terrain et l’élaboration d’un texte, il y a des transitions, des passages, tout un processus assez similaire à la traduction. Si le japonais est si difficile à traduire, c’est qu’il n’y a pas d’équivalent exact. La traduction n’est donc pas la juxtaposition d’une langue à une autre, c’est la transformation d’une langue dans une autre. Cela signifie que, dans la démarche scientifique, il existe aussi un processus de transformation. Les sensations que l’on éprouve et que l’on partage, il faut les traduire et les transformer dans un texte. Et c’est à chaque fois un défi. Pour dire les choses autrement, l’ethnographie ne dissocie pas l’étude des cultures (ethnos) de la question de l’écriture (graphé), elle fait précisément de leurs relations sa spécificité. Ce qui pose les questions suivantes : en quoi consiste la transformation du regard en langage ? Quelle relation y a-t-il entre la réalité sociale que nous observons et la réalité textuelle que nous produisons ? (…)
L’universel est au cœur du singulier. Il y a deux choses à fuir : la tendance à l’abstraction, qui n’existe qu’en Occident et que Wittgenstein appelle « la généralité des super-concepts » ; la croyance dans une prétendue singularité identitaire selon laquelle chaque société serait complètement unique, homogène, réfractaire à l’accueil des autres. C’est à partir de ce que vous avez observé et décrit en essayant d’être le plus précis possible que vous aboutissez, non pas à des « lois », mais plutôt à des tendances. Dans chaque société, il y a des tendances et des contre-tendances. L’Europe est riche d’enseignement à ce sujet ; il y a des tendances dominantes et toujours des contre-tendances, c’est la démocratie. D’ailleurs, dans la conception que nous avons du terrain, il y a une exigence démocratique. Cela nous amène à évoquer une autre question : celle du souci éthique dans le travail des chercheurs en sciences humaines et sociales, et en particulier des anthropologues. On ne peut pas dissocier souci épistémologique, souci politique et souci éthique (…)
Extraits d’une rencontre de Joris Thievenaz avec François Laplantine
in Éducation Permanente n° 230 pp. 21-30
→ voir l’intégralité de l’entretien sur
https://www.cairn.info/revue-education-permanente-2022-1-page-21.htm